« Dans le silence et l’ombre de l’âme illettrée quelle est donc cette vertu profonde ; et surtout quelle est cette grâce profonde ? N’est-ce pas la vertu même et la grâce du désarmement de l’ombre ? N’est-ce pas la grâce même du détendement de la nuit ? … L’homme se retourne vers sa race, vers cette longue nuit non troublée. Comme ce silence et cette ombre sont plus près de la création ! Comme ils sont seuls nobles ! »
Charles Péguy, Note conjointe
Une même idée traverse les esprits : dès que le nocturne prend la relève du diurne, l’ensemble des manifestations sonores s’atténuent progressivement. Ce principe vaut surtout pour les milieux à forte concentration démographique, donc principalement urbains, les environnements naturels (forêts, déserts, montagnes ou océans) conservant de leur côté un même volume sonore, quel que soit le moment de la journée. En ville, la nuit est généralement associée à l’abandon de la plupart des usages socio-professionnels, du fait du manque de visibilité, de la baisse des températures ou de la fatigue physique. L’humain l’utilise principalement en tant que période de répit1. Le monde n’est pas pour autant mis à l’arrêt mais son mouvement global connaît un ralentissement passager. S’est toujours posé le problème des tapages nocturnes, portant atteinte au silence communément admis et troublant la nécessaire tranquillité du cadre collectif. En effet, les conduites sociales impliquent la cessation des nuisances au-delà d’une certaine heure. En l’an 44 avant Jésus-Christ, Jules César impose une ordonnance visant à faire interdire toute circulation dans la grande cité romaine entre le coucher et le lever du soleil. Le silence devient dès lors une affaire publique inextricablement liée à ce principe astronomique qu’est le nocturne, comme si tout devait s’y taire. De ce fait, un silence émerge à la tombée de la nuit et, au fil des minutes, devient de plus en plus massif. Lors des premiers rayons lumineux de l’aurore, il s’éclipse par la résurgence des clameurs. Dans une formule dilatoire et interrogative, Max Picard affirme que « le silence de la nuit dissout les paroles du jour, elles s’y engloutissent2 ». S’ouvre alors un espace-temps vertigineux où les repères cartésiens vacillent et où d’autres jalons, plus indécis, se mettent en place.
Nombreuses pratiques artistiques exploitant la nuit comme thème ou comme horizon font logiquement ressortir sa dimension silencieuse par des situations apparemment dépourvues de tout tumulte ou brouhaha et où règne le sentiment d’un vide sonore finalement stimulant, riche de promesses. Ainsi, par leur contenu, leur atmosphère et les événements décrits, certaines toiles nocturnes3 suggèrent indéniablement un silence (du moins une absence de frénésie) tantôt apaisant, tantôt inquiétant : parmi elles, les nombreuses séries incluant le motif de la bougie que peint Georges de la Tour entre 1640 et 1645, les représentations romantiques impliquant le crépuscule ou même la Lune par Caspar David Friedrich de 1810 à 1835, quelques œuvres pré-expressionnistes de Léon Spilliaert dans les années 1900 sans oublier Automate, Fenêtres la nuit ou Nighthawks d’Edward Hopper durant l’entre-deux-guerres. S’y retrouvent plusieurs constantes : la luminosité réduite, des lieux désertés, une présence humaine très limitée voire écartée. Si l’observateur peut ne pas y voir une tendance au silence, tout au moins s’y constituent des ambiances feutrées et dépourvues de tout effet d’accumulation. On retrouve le même type de dispositif en photographie4 : certains clichés nocturnes de Brassaï, de Daniel Boudinet, de Chrystel Lebas ou d’Edward Steichein nous immergent dans des constructions visuelles tamisées5, dépeuplées, parfois même désanthropocentrées, laissant à penser que le paysage acoustique, certes imaginaire, ne nous ferait entendre que de lointaines rumeurs. Face à ce qui se donne devant notre regard, nous tentons de restituer mentalement un pendant sonore, même sans stimulation directe de l’ouïe. Mais qu’en est-il pour un art directement audiovisuel comme le cinéma ?
Si filmer la nuit ou de nuit implique de facto des aménagements lumineux et pose le problème de ce qui peut être vu (ou non) à l’image dans une obscurité plus ou moins marquée, cela induit aussi des décisions en matière d’arrangements acoustiques. Bruits, compositions musicales et intonations vocales ne s’équivalent pas en milieu diurne et en milieu nocturne. Au cœur de la nuit filmique, l’effet de résonance tranche plus nettement dans les espaces intradiégétiques, la dynamique des instruments d’accompagnement en off se révèle plus lente, les voix humaines se placent à un niveau décibélique de moindre portée… et le silence peut affleurer plus naturellement, plus rigoureusement, plus fondamentalement. Comment, en tant que donnée élémentaire du nocturne, le silence peut-il être restitué par le biais de l’approche cinématographique ? Plutôt que de repérer la coexistence du silence et de la nuit dans le plus grand nombre possible de films, il conviendrait de nous recentrer sur leur relation à l’intérieur d’œuvres relevant d’une même catégorie esthétique. En effet, certains genres cinématographiques ont davantage les faveurs du nocturne par rapport à d’autres, notamment le fantastique et l’horreur, mais plus encore le « film noir ».
Une mouvance tendant vers le nuiteux
Sans chercher à gloser sur les valeurs définitoires qui le caractérisent, rappelons simplement que, dans son acception classique, le « film noir » appartient au domaine du cinéma criminel, que ses personnages souvent marginaux flirtent avec l’illégalité et que, en ce qui nous concerne, les actions décisives se produisent en large partie durant la nuit6 et dans des décors réalistes7. Malgré la difficulté à circonscrire les spécificités de ce genre, Noël Simsolo note que « si cette mouvance donne de l’inspiration à ceux qui s’y aventurent, cela tient sans doute à la puissance de codes corollaires, à une dynamique forgée par des dispositifs formels : ombres masquant partiellement le décor et les visages, […] nuit pluvieuse et brumeuse provoquant un sentiment déstabilisant8 ». Certes, le « film noir » possède a priori quelques marqueurs sonores qui ne laissent que peu de place au silence : voix-off prenant en charge la narration, musique de fosse misant sur des compositions symphoniques ou jazzistes, bruits stridents (surtout les ronflements de moteurs de voitures et les coups de feu). Toutefois, quelques séquences de « films noirs », ou renvoyant au genre « film noir », font néanmoins le pari d’une dramaturgie jouant exclusivement sur un irrépressible silence sonore. Trois d’entre elles, issues successivement de La Dernière rafale (titre original : The Street With No Name, William H. Keighley, États-Unis, 1948)9, de Du rififi chez les hommes (Jules Dassin, France, 1955)10 et de Jours de 36 (Theo Angelopoulos, Grèce, 1972)11, vont retenir notre attention dans la suite du texte.
Ainsi, nous partirons chronologiquement du modèle académique américain (Keighley) pour nous orienter vers une reproduction distanciée (Dassin) avant d’en arriver à une radicalisation moderniste (Angelopoulos)12. Les trois séquences s’engagent sur le terrain du nocturne et se laissent imprégner par un silence relativement catégorique, résultat d’un manque de parole ainsi que d’un opérant élagage musical. Avant de les associer plus étroitement par analyse comparative, il convient de décrire chacune d’elles en nous souciant de la manière dont elles exploitent le nocturne en tant que ligne de force dans leur mise en scène13 et condition temporelle propice à l’émergence du silence ambiant.
La nuit comme théâtre commun des méfaits
Si l’on dit souvent que minuit est l’heure du crime, c’est en raison de l’obscurité ou de la désaffectation des espaces collectifs14. Avec l’affaiblissement de la clarté (néanmoins compensé par les éclairages électriques) ou la fréquentation considérablement diminuée des habituels lieux publics, il y devient possible d’agir illicitement avec davantage de latitude. Mais a contrario, opérer dans de telles conditions comporte un risque considérable car c’est dans le calme profond que tout son strident peut être immédiatement repéré et toute activité inhabituelle devenir suspecte. Les personnages des trois films concernés prennent l’initiative de manœuvrer secrètement à une heure bien avancée de la nuit, ayant connaissance des périls mais procédant de manière méthodique15.
L’intrigue de La Dernière rafale se base sur une rigoureuse enquête policière. Un agent du FBI réussit à s’infiltrer dans un gang new-yorkais. Durant une nuit, il se rend discrètement dans leur repère, situé au fin fond d’une cave d’immeuble, afin d’examiner de plus près le pistolet appartenant au chef de bande (joué par Widmark). Le policier soupçonne cette arme à feu d’avoir précédemment servi à commettre plusieurs assassinats et braquages. De façon à obtenir une preuve irréfutable, il doit en extraire une balle et l’envoyer au laboratoire pour la comparer avec celles trouvées sur les lieux de récents crimes. Hélas, le chef de bande retourne au repère dans le même laps de temps. C’est durant ce chassé-croisé d’une durée de cinq minutes que s’installe un long silence sonore, à peine occupé par quelques bruits résiduels. L’action débute dans une impasse peu fréquentée, sorte d’antichambre du silence (fig. 1).

Fig. 1. La Dernière rafale (lieux désengagés).
En se faufilant à l’intérieur du local, l’agent infiltré se retrouve dans l’obscurité totale, uniquement guidé par sa lampe-torche qui lui permet d’avancer de manière incertaine dans un espace encombré (fig. 2 et 3). Les seuls bruits entendus durant la première partie de son trajet sont ceux qu’il émet : le levier permettant de déverrouiller la porte dérobée de l’arsenal, le pistolet qu’il manie. Avant de tirer un coup de feu avec l’arme, il l’enroule dans un drap trouvé au sol et appuie le canon contre un matelas épais. Ainsi, le tir est doublement étouffé et la balle plus facilement récupérable. L’arrivée soudaine d’une voiture (conduite par le chef de gang) oblige l’agent à s’extirper du local au plus vite.

Fig. 2. La Dernière rafale (un faible éclat dans les ténèbres).

Fig. 3. La Dernière rafale (un faible éclat dans les ténèbres).
Mais sa lampe projette de vifs éclats de lumière à travers la vitre du soupirail, ce qui ne manque pas d’attirer l’attention du gangster (fig. 4 et 5). Celui-ci entre à son tour dans le repère et allume l’interrupteur, amenant un surcroît d’éclairage électrique dans le cellier et empêchant le policier de pouvoir rester dissimulé dans la pénombre. L’enquêteur parvient tant bien que mal à s’échapper par une salle de boxe située à l’étage supérieur mais claque malencontreusement une porte, percute un sac de frappe dont les suspensions grincent et oublie de fermer derrière lui l’issue de sortie. Il laisse ainsi bien trop d’indices de son effraction nocturne pour ne pas éveiller les soupçons du gangster. En ce sens, les braqueurs chez Jules Dassin sont plus efficaces.

Fig. 4. La Dernière rafale (la lumière comme agent du drame).

Fig. 5. La Dernière rafale (la lumière comme agent du drame).
Du rififi chez les hommes prend place dans le Paris nocturne des années 1950. Quatre hommes organisent en pleine nuit le cambriolage d’une bijouterie. Pour parvenir à leurs fins, il leur faut dompter l’ensemble des conditions nocturnes avant le passage à l’acte. Ils auront donc visité la boutique en se faisant passer pour des clients potentiels, identifié le système de sécurité, quadrillé tout le quartier, scruté les habitudes des riverains et effectué plusieurs simulations. Le braquage se déroule en plusieurs étapes différentes et se termine lorsque le jour se lève. Soucieux de ne pas éveiller l’attention, les voleurs s’exécutent avec prudence. Ils pénètrent dans l’immeuble mitoyen de la bijouterie, ligotent les concierges, prennent l’ascenseur pour se rendre au premier étage et s’apprêtent à franchir un appartement inoccupé. C’est au moment où la caméra cadre la porte d’entrée du lieu d’habitation (fig. 6) que la ponctuation musicale, enjouée et dramatique, passe en mode diminuendo puis se retire définitivement.

Fig. 6. Du rififi chez les hommes (au seuil du silence).
Nous pouvons enfin entendre ce que les personnages entendent également, être rattachés à leur point d’écoute et apprécier la teneur du silence. Durant les six heures de braquage, condensées sur vingt minutes de film, aucune réplique ne sera échangée. Chacun des individus s’en tient à son rôle et sait ce que ses comparses attendent de lui. Qu’ils ouvrent un trou dans le sol par-dessus la bijouterie pour s’y introduire (fig. 7) ou déplacent un lourd coffre-fort, les protagonistes s’engagent dans une éprouvante épreuve physique sans jamais laisser s’échapper le moindre bruit incontrôlé. Marteaux ou perceuses sont drapés dans des torchons afin d’en contenir la charge sonore. Le système d’alarme de la bijouterie est aspergé avec un gel d’extinction pour que sa sonnerie soit étouffée. À plusieurs reprises, sur ordre de l’un d’eux, les braqueurs s’arrêtent de travailler et éteignent tous les éclairages : l’heure indiquée sur leur montre correspond à celle de la ronde de nuit d’un gendarme, d’un camion de nettoyage ou de diverses livraisons marchandes, les obligeant à rester immobiles durant quelques secondes. Ils ne rallument les lampes qu’une fois le danger écarté. Dès qu’ils ont mis la main sur les diamants, les cambrioleurs repartent comme ils sont arrivés. Jusqu’à ce qu’ils aient définitivement évacué les lieux, les hors-la-loi ne troubleront point ce silence nocturne qui leur sert d’allié16. Mais ce même principe peut être utilisé par les représentants de l’ordre dans une logique répressive, comme chez Théo Angelopoulos.

Fig. 7. Du rififi chez les hommes (cambriolage sans aucun bruit).
Son titre l’indique en partie : Jours de 36 se déroule durant l’année 1936, au sein d’une Grèce administrée par la dictature du Général Metaxas. Un syndicaliste, détenu en prison, prend en otage un ministre. Barricadé durant toute une journée dans un bureau donnant sur la cour intérieure du pénitencier, ce syndicaliste exige des négociations avec le gouvernement. Mais celles-ci n’aboutissant pas à la tombée de la nuit, un tireur d’élite est mobilisé pour régler l’affaire. Le point culminant du film procède en une exécution savamment orchestrée par les forces de l’ordre pour neutraliser définitivement le militant, le tout sur fond de silence abyssal. La séquence, proche du temps réel, se déroule sur trois minutes et trente secondes. L’action n’a certes pas lieu en plein centre urbain mais, avec sa forte densité de population, son réseau d’éclairages électriques et ses couloirs labyrinthiques, le lieu de détention s’y prête quelque peu. Au début de la séquence, le tireur vient se placer au milieu de la cour intérieur de la prison, configurée comme un large cercle lumineux (fig. 8).

Fig. 8. Jours de 36 (circularité et conspiration).
D’un geste de main, il ordonne l’extinction de tous les éclairages à l’exception de ceux du bureau où a lieu la prise d’otages (fig. 9 et 10). Par la fenêtre de ce bureau, dont les vitres sont floutées, nous ne voyons que des formes humaines à la manière d’ombres chinoises. L’ensemble du lieu nous plonge dans un silence intriguant. Se font néanmoins entendre trois bruits distincts : le chant des grillons, présent en permanence ; les déplacements dissimulés des gardes, qui se positionnent autour de la fenêtre éclairée ; et enfin, ce qui semble être le hululement régulier d’un volatile. La caméra se laisse entraîner dans un panoramique sur 720 degrés, d’où ne ressortent que des bordures de remparts ou des fragments de la façade principale.

Fig. 9. Jours de 36 (soudain, l’obscurité ou presque).
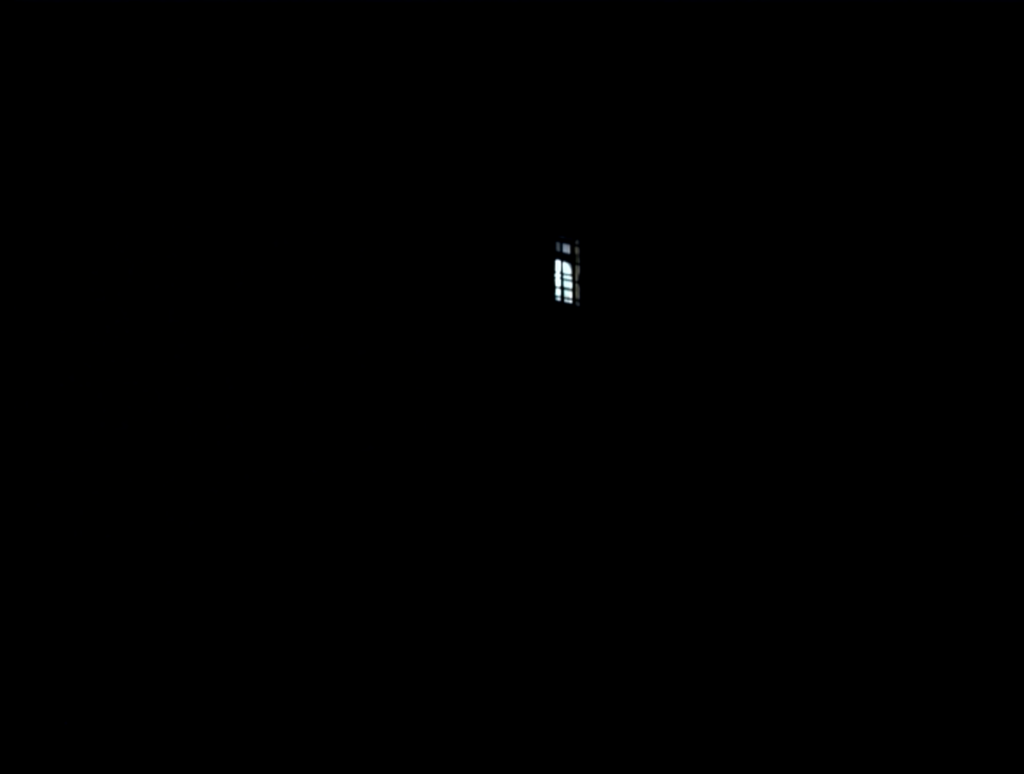
Fig. 10. Jours de 36 (soudain, l’obscurité ou presque).
Nous voyons progressivement un soldat accédant au toit et se plaçant juste au-dessus de la fenêtre. Précisons que si celle-ci a été faite en chaux et empêche de voir correctement au travers, sa partie supérieure est complètement transparente. Le soldat, ainsi positionné depuis le toit, peut donc visualiser l’intérieur du bureau. Il lance soudainement un mouchoir blanc (fig. 11). Ce signal permet au tireur, qui n’a pas bougé entre-temps, de faire détonner son arme à feu. La fenêtre est alors immédiatement perforée par un trou. Le preneur d’otages vient d’être abattu. L’opération secrète prend ainsi fin. Les éclairages du lieu sont relancés. Les gardiens se déploient de nouveau dans l’enceinte de la prison, relativisant considérablement le silence nocturne. Celui-ci ne leur est désormais plus d’aucune utilité.

Fig. 11. Jours de 36 (instant tragique : lumière vive et bruit ponctuel).
Dans les trois séquences, l’approche scénique, méticuleuse et soupesée, va de pair avec les complots fomentés par les protagonistes. La part de hasard n’y a pas sa place. Ce que ces films affirment, c’est que le silence interne possède une valeur dramaturgique et se suffit à lui-même pour générer une quelconque dynamique. Aucune contribution musicale n’a donc besoin d’être convoquée. Ne pas parler y devient essentiel pour n’être ni entendu, ni identifié, ni localisé. Les propriétés du nocturne y font l’objet d’une forme de respect. L’ensemble des personnages s’appuient sur l’obscurité mais celle-ci peut, en cas de phénomènes lumineux indésirables, se retourner contre eux. Il leur faut s’acclimater et ne pas laisser la nuit les prendre au piège. Au sein des ténèbres et du silence profond, les protagonistes parviennent à s’orienter à tâtons mais doivent rester systématiquement sur leurs gardes. Il n’y a aucune place pour l’approximation et toute erreur pourrait leur porter gravement préjudice. Mais au-delà de cette logique narrative qui conditionne les trois séquences, qu’est-ce qui, au niveau figuratif, confirme la convergence entre pénombre et silence ?
Matières audiovisuelles de l’obscur
Presque sur-signifiants, les sons et les éclairages obéissent ici aux mêmes propriétés : ce sont des points de balisage permettant d’apprécier, ne serait-ce que grossièrement, la configuration des lieux ou leur étendue globale. Dans ces nappes de silence et d’obscurité induisant la dépossession figurative, l’attention du spectateur comme celle des personnages s’accroît. Il devient alors clair que le rapport entre le silence et les nuances de bruit, de même que celui entre l’obscurité et les éclats de lumière, se base sur une structuration entre un fond vide et des figures susceptibles de l’occuper, d’y vivre de manière autonome et d’y faire « l’épreuve de durées inégales17 ».
Au niveau du programme visuel, la distribution lumineuse dans les trois situations demeure éclatée, les zones éclairées restant sous forme de découpes dégagées d’une ombre englobante18. Il y a néanmoins des variations dans le travail d’éclairage, toujours justifié au niveau diégétique19 : nous passons du high-key au low-key (quand ce n’est pas l’inverse)20, mais toujours dans un va-et-vient régulier, engageant une tension systématique entre l’ombre et la lumière, tour-à-tour réquisitionnées puis destituées. Pointent des confusions sur la nature de certaines ombres, surtout chez Keighley : dans la salle de boxe, sont-elles propres ou portées (fig. 12) ?

Fig. 12. La Dernière rafale (règne de l’ombre propre et/ou portée).
La séquence de l’exécution chez Angelopoulos, empruntant les codes visuels des films noirs traditionnels, cherche l’intensification : une nuit encore plus sombre, des contrastes lumineux davantage soulignés et une architecture globale tendant vers l’abstraction. Même si le film a été conçu en couleurs, la configuration visuelle dans cette prison tamise tellement le contenu du champ que domine la vive sensation de n’avoir d’autres bases chromatiques qu’un noir à peine bleuté et un blanc blafard. Selon toute vraisemblance, le cinéaste a néanmoins dû recourir à un faible spot lumineux, mobile et aligné dans le même axe que la caméra, afin d’éclairer très légèrement le champ. Sans cette solution technique, la nuit aurait été, pour ainsi dire, d’un noir bien trop opaque.
De plus, dans chacun des lieux, les fenêtres ne fonctionnent pas comme cadres internes mais comme interfaces potentiellement résolutives. C’est par elles que le drame peut survenir ou que les présences peuvent se trahir : dans ces ténèbres, elles deviennent le lieu de la toute-visibilité. Le policier de La Dernière rafale ne se rend pas compte que le soupirail renvoie vers l’extérieur les rayons de sa lampe-torche. Le syndicaliste de Jours de 36 ne sait pas que seule l’ampoule provenant des vitres du bureau est restée allumée. Les quatre cambrioleurs de Du rififi chez les hommes, eux, ont parfaitement conscience du piège que représentent les fenêtres en tant que sources lumineuses et pallient en conséquent à cette difficulté.
En revanche, la dimension acoustique connaît une certaine immutabilité dans les trois films, entre le vacarme que l’on veut éviter et la tranquillité que l’on cherche à maintenir. L’audible s’y évanouit, l’inaudible y surgit. Qu’il s’agisse d’un claquement de porte, d’un coup de marteau, d’un grincement de plancher, quelques bruits tranchants pourraient parfois être évités mais témoignent de l’impossibilité d’un silence tout à fait complet. Moult sons isolés (générés par un pistolet, un maillet ou une foreuse) se détachent très nettement de cette accalmie apparente, devenant des rugosités sonores et contrariant un silence décidément imparfait. Ils ne sont jamais espacés d’un laps de temps suffisamment durable qui donnerait l’impression d’un néant sonore.
Le silence se propage aussi bien dans la profondeur, dans la latéralité que dans la verticalité des espaces visibles : d’une impasse de ruelle jusqu’à un cellier de cave, d’une boutique de luxe jusqu’au local d’un concierge, d’une cour intérieure de prison jusqu’aux toits, il circule et se disperse sans heurt. Celui présent chez Keighley s’avère tout particulièrement raréfiant, phénomène assez surprenant pour un film hollywoodien classique. N’en jaillissent qu’une poignée de sons ouatés. La nuit dans le film de Dassin est considérablement calme, mises à part quelques allées-et-venues dans les rues voisines, mais se voit contrariée par les agissements des braqueurs. À proximité de la prison d’Angelopoulos, placée dans un territoire plus reculé, des sons davantage naturels font acte de présence en tant que substrat et nuancent le silence. Le nocturne s’y démarque légèrement des deux autres films car davantage peuplé d’éléments sonores très réguliers et ne pouvant être tus. Le seul bruit décisif y est le coup de feu, écorchant le continuum sonore et s’érigeant en événement prépondérant. En toutes circonstances, le silence ne disparaît pas soudainement de ces espaces nocturnes. Ce qui y met un terme passe par une ellipse au montage, concrétisant ou symbolisant l’avènement du jour.
Grâce au silence, le cadre est davantage scruté et valorisé. Hormis Angelopoulos21 qui maintient les individus à distance de sa caméra, plusieurs gros plans chez les deux autres cinéastes interviennent régulièrement, présentant des visages crispés, aux traits parfois grimaçants, et révélant des attitudes systématiquement en état d’alerte. L’obscurité silencieuse sied bien aux uns et autres, les sauvegardant par son enveloppe protectrice mais sans pour autant les épargner durablement, d’où leurs expressions faciales, vulnérables et craintives. Le lien à la matière, par contact tactile, devient plus précis. Au sein de nos séquences, les personnages palpent avec précaution tout ce qui se trouve à leur portée. Ils éraflent aussi de nombreux matériaux – matelas en mousse, parquets en bois, coffres métalliques ou vitres en verre – comme si, au milieu de l’obscurité, ils cherchaient à percer une ouverture, déchirant furtivement le silence pour s’engouffrer vers le noir ou vers la lumière. Les perforations occasionnées dans le décor, point de convergence des énergies, se pensent comme des brèches dans l’image première et y déploient une autre profondeur : s’y insèrent une balle de revolver (Jours de 36 ou La Dernière rafale), une main (La Dernière rafale ou Du rififi chez les hommes) ou un corps humain (Du rififi chez les hommes) (fig. 13, 14 et 15). À travers de tels événements dans l’image et par l’image, on peut voir le signe d’une crise objectale qui serait celle propre au « film noir ». Anne-Françoise Lesuisse précise à propos de ce genre que « dans cette absence de forme stable qui le caractérise, une qualité apparaît […] : une mise à la question de la notion de forme, considérée dans ses aspects représentationnels, dans ses lignes claires et délimitantes, dans son détachement d’un fond22 ». Ce fond en question pourrait bien être son identité nocturne, investi comme dépôt de formes figuratives, tant au niveau visuel qu’auditif.

Fig. 13. La Dernière rafale (activation du contact tactile).

Fig. 14. Du rififi chez les hommes (vers une trouée décisive).

Fig. 15. Du rififi chez les hommes (se faufiler dans les brèches).
Avec les ténèbres de la nuit, l’expérience spectatorielle se trouve happée dans cet artificiel nocturne cinématographique et devient donc plus engageante. Contrairement à ce que dit David Le Breton sous forme de constat global, à savoir que « la conjugaison du silence et de la nuit est également propice à l’immersion de soi dans la sérénité des lieux23 », l’association amène systématiquement un surcroît de tension, voire même d’angoisse diffuse, dans les quelques situations cinématographiques étudiées. Face à de tels moments d’indétermination, la réactivité s’exacerbe. Le clair-obscur devient l’arrière-plan de traques, d’escapades et de dérobades où des obstacles doivent être contournés et des pièges solutionnés, autant sur le plan dramaturgique que formel. Nous aurons vu que ces héros noctambules tendent vers un but précis : une preuve criminelle, un butin, un assassinat. Qu’ils improvisent sur l’instant ou qu’ils aient anticipé le moindre détail, ils parviennent à atteindre les objectifs visés. Toutefois, ceux-ci ne sont pas montrés tels quels à l’écran : ni la fuite du policier, ni les diamants de la bijouterie, ni le corps du preneur d’otages n’apparaissent, car relégués en dehors du champ en tant qu’événements secondaires. L’essentiel se trouve ailleurs : cette traversée prolongée dans un silence nocturne que personne ne doit outrepasser et que rien ne doit dépasser. Nos personnages espèrent que les autres humains resteront sourds et aveugles face à leurs manigances. Être saisis dans la lumière, être de nouveau audibles reviendrait pour eux à être mis en échec24.
Quant à la réapparition du diurne, de la profusion verbale et/ou de la ponctuation musicale, elles provoquent la dissolution des possibilités formelles qui, dans ces différentes séquences de films, commençaient tout juste à se dessiner, à s’instruire et à s’imposer, par le biais de trouées et d’impacts, de chocs et de frottements, de pénétrations et d’exfiltrations, de ravalements et d’éruptions25. Réaffecter le visible sans zones d’ombre et l’audible sans phases de silence, c’est renoncer à ces structures alternatives permises par le nocturne… mais sans y mettre fin. Reléguées à l’état de puissance, elles attendront, patiemment, que la prochaine nuit les réhabilite.
Louis Daubresse
- « La nuit a longtemps été appréhendée comme une discontinuité, le temps des ténèbres […]. Par extension, symbolisée par le couvre-feu, l’arrêt de toute activité, la fermeture des portes de la cité, elle fut longtemps considérée comme le temps du repos social. », Luc Gwiazdzinski, La Nuit, dernière frontière de la ville [2005], Paris, Rhuthmos, coll. « Rythmanalyses », 2014, p. 97. ↩︎
- Max Picard, Le Monde du silence, Vendôme, Presses Universitaires de France, coll. « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine », 1953, p. 108. ↩︎
- « Lier silence et peinture peut apparaître comme une tautologie. Et si la peinture est un être de silence, le spectateur n’échappe pas, lui, à sa condition d’être-de-langage. Ainsi, au-delà de cette évidence, peut-on évoquer comme un enjeu majeur, tant dans l’histoire des idées que dans la définition de la nature même du procès pictural, le silence en peinture : le silence dans la peinture et silence de la peinture. », Annie Gutmann, « Entendre la peinture » dans Claudie Danziger (dir.), Le Silence : la force du vide, Paris, Autrement, coll. « Mutations », n° 185, 1999, p. 120. ↩︎
- Même si, à vouloir lier silence et photographie, il y aurait là aussi un truisme comme en peinture. Encore une fois, distinguons le silence inhérent à la photographie en tant que médium et le silence suggéré par le contenu de certaines photographies. ↩︎
- Plus de précisions dans l’ouvrage de Judith Langendorff où sont analysés au fil des pages les travaux de ces différents artistes. Cf. Judith Langendorff, Le Nocturne et l’émergence de la couleur : cinéma et photographie, Rennes, PUR, coll. « Aesthetica », 2021. ↩︎
- Ibid., p. 37. Langendorff rappelle à ce propos que la nuit urbaine apparaît très sombre dans les « films noirs » de la première heure, prenant pour exemples Odd man out (Carol Reed, 1947), Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) ou Kiss me Deadly (Robert Aldrich, 1955). De plus, plusieurs de ces films noirs font directement référence à l’univers de la nuit par leurs titres originaux : Nocturne (Edwin L. Main, 1946) ; He Walked by Night (Alfred L. Werker, 1948) ; They Live By Night (Nicholas Ray, 1948) ; Clash by Night (Fritz Lang, 1952) ; The Midnight Story (Joseph Pevney, 1957). ↩︎
- Ce qui fait dire à Jean-Pierre Esquenazi que dans le monde de référence du film noir, il y a d’abord la perfide ville noire, réseau ramifié de tentacules obscures, labyrinthe objectif qui enserre les individus vivant leurs vies ordinaires et à partir duquel il devient pertinent de parler de réalisme du genre. Cf. Jean-Pierre Esquenazi, Le Film noir : histoire et significations d’un genre populaire subversif, Paris, CNRS, coll. « Cinéma & audiovisuel », 2012, p. 252 et p. 287. ↩︎
- Noël Simsolo, Le Film Noir : vrais et faux cauchemars, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 2005, p. 13. ↩︎
- Pour rappel, le cinéaste William H. Keighley a tourné quelques films de gangsters pour la Warner avant la Seconde guerre mondiale. Il collabore ici avec le chef opérateur Joseph MacDonald, dont l’approche semi-documentaire, notamment sur Call Northside 777 (Henry Hathaway, 1948) ou Panic in the Streets (Elia Kazan, 1950), a été déterminante dans la nouvelle dynamique du film noir d’après-guerre. La présence de Richard Widmark, spécialiste des rôles de criminel sociopathe, s’ajoute aux autres marqueurs déterminants et fait de La Dernière rafale, pourtant assez méconnu du grand public, un exemple archétypal. ↩︎
- Avec The Naked City (1948) et Night and the City (1950), Jules Dassin devient une valeur sûre du cinéma outre-Atlantique mais doit s’exiler en Europe durant la terrible période maccarthyste à cause de son ancienne adhésion au Parti Communiste américain. Par Du rififi chez les hommes, le réalisateur exporte la formule initiale du « film noir » et la transpose dans un univers français avec ses propres spécificités culturelles. L’implication de Philippe Agostini, chef opérateur et ancien collaborateur de Marcel Carné, fait office de retour à l’envoyeur : en effet, les « films noirs » américains des années 1940 s’inspirent en partie de l’atmosphère nocturne des drames du « réalisme poétique » français de la décennie précédente. ↩︎
- Tourné durant une période de régime militaire particulièrement autoritaire en Grèce, Jours de 36 compose avec un certain nombre de non-dits et de paroles inintelligibles. Certes, il ne répond pas vraiment aux dispositions narratives et esthétiques du « film noir ». Il n’empêche que, comme le disent Michel Ciment et Hélène Tierchant, le réalisateur Theo Angelopoulos reste conscient des formes passés du cinéma et reconduit les genres hollywoodiens sous bénéfice d’inventaire. Cf. Michel Ciment, Hélène Tierchant, Théo Angelopoulos, Paris, Edilig, coll. « Filmo », 1989, p. 9-10. En outre, ce cinéaste fait appel à Yórgos Arvanítis, aujourd’hui directeur de la photographie très réputé en Europe. Arvanítis a travaillé sur onze des treize films qu’Angelopoulos a tourné durant sa carrière. ↩︎
- Par un mouvement de proche en proche, on peut aussi apprécier un déplacement culturel : le film de Keighley reste un produit issu du mainstream hollywoodien, celui de Dassin apparaît comme un exercice de transition avant que le cinéaste ne termine sa carrière en Grèce, pays d’Angelopoulos. ↩︎
- Précisons que les films de Keigley et de Dassin ont été tournés en noir-et-blanc, même s’il existe une version colorisée (au demeurant fort dispensable) de Rififi…, tandis que celui d’Angelopoulos fut réalisé en couleurs. ↩︎
- « Tout un système de grilles basculantes, une machinerie de règles et d’intérêts, de permissivité et de répression font de la nuit urbaine un labyrinthe clos/ouvert, engageant/repoussant. », Anne Cauquelin, La Ville, la Nuit, Paris, Presses universitaires de France, coll. « La Politique éclatée », 1977, p. 71. ↩︎
- Esquenazi rappelle que « peu de films noirs échappent à la nuit, le moment où les grandes villes se métamorphosent, où une géographie quadrillée cède la place à un désordre scandé par la brillance des néons et l’obscurité des ruelles. Dans cet univers, les sources lumineuses sont de peu de poids par rapport à l’ombre : elles n’éclairent que des fragments de la cité de telle sorte que l’éphémère et le fragile dominent. Les personnages n’émergent que provisoirement ; ils se détachent à peine de l’ombre ambiante. Ou bien bénéficient d’une clarté soudaine ; les visages sont alors tendus, soucieux de leur fragilité parce que trop visibles. », Jean-Pierre Esquenazi, op. cit., p. 288-289. ↩︎
- Jean-Pierre Melville s’en inspire en très large partie pour la réalisation d’un autre casse, devenu morceau de bravoure cinématographique, au sein du Cercle rouge (1970). ↩︎
- Je reprends cette expression à Luc Vancheri pour qui le cinéma se définit figuralement par une visibilité flottante, ce qui vaut encore plus dans des situations nocturnes. Cf. Luc Vancheri, Les Pensées figurales de l’image, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/Arts visuels », 2011, p. 10. ↩︎
- Comme le rappelle Jacques Aumont, « l’ombre, bien sûr, a aussi le pouvoir menaçant de recouvrir toute figure, elle peut devenir un manteau de nuit », Jacques Aumont, Le Montreur d’ombre, Paris, Vrin, coll. « Essais d’art et de philosophie », 2012, p. 157. ↩︎
- Que ce soit chez Keighley, Dassin ou Angelopoulos, jamais le contenu du champ ne s’assombrit totalement, contrairement à ce qui peut se produire dans des séquences issues de films tels que Sous les toits de Paris (René Clair, 1930), Une femme est une femme (Jean-Luc Godard, 1961) et Le Cheval de Turin (Béla Tarr, 2011) où, du fait de l’abolition de toute forme de luminosité, le champ de la caméra s’inonde dans le noir pendant une durée filmique de quelques minutes. ↩︎
- Ces deux systèmes d’éclairage cinématographique reposent sur l’omniprésence ou l’exclusion de sources lumineuses, quelle que soit leur nature. ↩︎
- Le cinéaste grec a toujours privilégié la cinématographie du groupe, l’humain dans son caractère individuel disparaissant au profil de collectivités sociales. ↩︎
- Anne-Françoise Lesuisse, Du film noir au noir : traces figurales dans le cinéma hollywoodiens, Bruxelles, De Boeck université, coll. « Arts & cinéma », 2002, p. 7. ↩︎
- David Le Breton, Du silence, Paris, Métailié, coll. « Traversées », 1997, p. 150. ↩︎
- Ce qui ne manque pas de rappeler la formule suivante d’Edmund Burke : « Une lumière qui tantôt apparaît et tantôt s’éclipse, est plus terrible encore que l’obscurité totale ; et, pour peu que les conditions s’y prêtent, certains sons incertains sont plus alarmants qu’un silence total. », Edmund Burke, Recherches philosophiques sur l’origine de nos idées du sublime et du beau [1757], traduit de l’anglais par Baldine Saint Girons, Paris, Vrin, 2014, p. 162. ↩︎
- Ce qui rejoint un des principaux arguments de Langendorff, à savoir que la lisibilité d’une image passe davantage par les contrastes nocturnes (grâce aux distorsions, sublimations et transfigurations des éléments visuels). Si l’obscurité opacifie et révèle en même temps, il en va de même pour le silence : il trouble tout autant qu’il dévoile. ↩︎
